Dans cet épisode, Florence, experte en droit social, et Jérôme Lieutier, directeur des risques professionnels chez Ayming, abordent un sujet crucial mais encore trop peu maîtrisé : la gestion des accidents du travail des intérimaires.
Depuis le 5 juillet 2024, les entreprises utilisatrices (EU) supportent désormais 50 % des coûts liés aux AT/MP des intérimaires, contre 33 % auparavant. Une évolution applicable à tous les accidents, même mineurs, qui fait peser un risque financier important sur les EU, souvent mal informées et dépourvues de moyens d’action.
Ce que vous découvrirez dans l’épisode :
- Les impacts concrets du nouveau cadre réglementaire sur la répartition des responsabilités entre ETT et EU
- Pourquoi les EU payent plus sans pouvoir contester directement les décisions de la CPAM
- Les leviers à activer pour prévenir les accidents, mieux déclarer et inciter les ETT à contester lorsque nécessaire
- Les chiffres clés : 650 000 intérimaires en France et deux fois plus d’accidents graves que chez les salariés permanents
Vous avez apprécié cet épisode ? Partagez vos réflexions et découvrez comment ces enseignements peuvent enrichir vos pratiques RH.
Introduction aux accidents du travail et à l’intérim
Florence Bernier : Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la voix des RH, le podcast d’Ayming que j’ai l’honneur de présenter une nouvelle fois.
Je suis Florence Bernier-Debbabi, experte en droit social. Même si j’accompagne les entreprises sur ces sujets au quotidien, je dois reconnaître qu’il existe certains domaines très techniques sur lesquels je ne suis pas spécialiste. C’est précisément pour cela que j’ai le plaisir d’accueillir aujourd’hui quelqu’un qui l’est.
Nous allons parler des accidents du travail dans le cadre de l’intérim, ou du travail temporaire. C’est un sujet que je connaissais mal et dont la préparation de cet échange m’a fait prendre conscience de l’importance, tant il concerne un grand nombre d’acteurs.
Je te propose donc de rentrer directement dans le vif du sujet. Jérôme, je te laisse te présenter.
JÉRÔME LIEUTIER: Bonjour Florence, je suis ravi de participer à ce podcast consacré à l’intérim et au recrutement.
Je suis Jérôme Lieutier et j’évolue depuis 25 ans dans le conseil en performance RH. C’est un domaine vaste, car chaque entreprise a ses propres problématiques RH, et j’ai eu l’occasion d’intervenir dans de nombreux secteurs.
Pendant 23 ans, j’ai accompagné les entreprises sur les sujets d’intérim et de recrutement spécialisé — c’est d’ailleurs ma première expertise, qui me permettra d’échanger en profondeur avec toi sur ce thème. Depuis deux ans, je travaille plus spécifiquement sur la performance en risque professionnel : tout ce qui touche à l’accompagnement des entreprises sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
J’ai donc, un peu par le hasard des carrières, développé une double compétence : intérim et accidents du travail. Cela me permet aujourd’hui d’apporter une vision à la fois côté entreprise et côté travail temporaire. L’objectif de cet échange, c’est de rendre tout cela concret, de répondre à tes questions, de partager quelques astuces, et d’apporter un éclairage complémentaire sur un sujet aussi technique qu’essentiel.
FLORENCE BERNIER : Absolument. Pendant tout cet épisode, nous parlerons à la fois des entreprises de travail temporaire — que je me permets de préciser à nos auditeurs : nous les appellerons régulièrement ETT pour aller plus vite — et des entreprises utilisatrices, c’est-à-dire celles qui font appel à l’intérim.
J’imagine d’ailleurs que ce sont souvent elles qui t’interrogent, car ce sont elles qui ont un besoin de ressources humaines. On les désignera parfois par l’acronyme EU. Je pense que toi tu l’emploies naturellement, alors que de mon côté, j’y suis un peu moins habituée.
Commençons par quelque chose d’assez simple — mais je suis persuadée que ceux qui nous écoutent se posent la question.
Pourquoi, aujourd’hui, le sujet des accidents du travail dans le cadre de l’intérim mérite-t-il une attention particulière ? Pourquoi est-ce important d’en parler maintenant ?
Réforme de juillet 2024 et impact sur les accidents du travail et l’intérim
JÉRÔME LIEUTIER: Dans mes missions, j’accompagne aussi bien des entreprises de travail temporaire (ETT) que des entreprises utilisatrices (EU). Je ne suis donc pas « plus d’un côté que de l’autre ». J’ai d’abord travaillé au sein d’une ETT, au service des entreprises utilisatrices, et aujourd’hui j’interviens auprès des deux. Finalement, tout ce petit monde partage la même histoire : celle du salarié qui, à un moment donné, a eu un accident du travail.
Pourquoi est-ce que ce sujet revient sur le devant de la scène aujourd’hui ?
Tout simplement parce que, pendant des années, la réglementation n’avait pas bougé. Chacun — ETT d’un côté, entreprise utilisatrice de l’autre — avait sa part de responsabilité et sa part de charge financière.
Et puis, du jour au lendemain, en juillet 2024, alors qu’on parlait partout de dissolution à l’Assemblée, un décret est sorti le 5 juillet. Il change complètement la donne en instaurant une nouvelle répartition du coût des accidents du travail dans le cadre de l’intérim.
Jusqu’à présent, pour résumer :
- Sur les accidents graves, l’ETT assumait 66 % du coût, et l’entreprise utilisatrice 33 %.
- Sur les accidents non graves (avec arrêt mais sans séquelles lourdes), tout était à la charge de l’ETT.
Depuis le 5 juillet 2024, c’est terminé. Tous les accidents — graves ou non — sont désormais partagés à 50/50 entre l’ETT et l’entreprise utilisatrice.
Ce changement n’est pas tombé du ciel : il était porté depuis longtemps par les partenaires sociaux, le syndicat des entreprises de travail temporaire, mais aussi certaines branches professionnelles. L’objectif était clair : rééquilibrer les rôles et reconnaître que la protection du salarié accidenté est un sujet commun, qui doit être assumé équitablement par les deux parties.
FLORENCE BERNIER : D’accord. Donc, si je résume, en juillet 2024 il y a eu un changement majeur : on a revu la manière dont les coûts des accidents du travail sont répartis. C’est bien ça ?
JÉRÔME LIEUTIER: Oui.
FLORENCE BERNIER : Donc si je comprends bien, on rééquilibre la répartition des coûts entre l’ETT et l’EU. Sur le principe, ça paraît logique : après tout, c’est bien l’entreprise utilisatrice qui fait appel au salarié intérimaire et qui l’emploie au quotidien.
Mais concrètement… ça veut dire que les EU vont voir leurs coûts augmenter, non ?
JÉRÔME LIEUTIER: Oui, tout à fait. Cette nouvelle réglementation a en réalité deux impacts majeurs.
Premier point : elle est rétroactive. Lorsqu’elle a été publiée en juillet 2024, il a été décidé que tous les accidents du travail survenus depuis le 1er janvier 2024 seraient désormais répartis à 50/50 entre l’ETT et l’entreprise utilisatrice.
C’est assez rare d’avoir un effet rétroactif sur ce type de sujet, mais cela permet d’aligner plus facilement les cotisations sur une base annuelle.
Deuxième point : l’effet financier n’est pas immédiat. En matière d’accidents du travail, l’impact sur les cotisations met deux ans à apparaître.
Concrètement :
- Les accidents survenus en 2024 commenceront à impacter les cotisations des EU à partir de janvier 2026.
- L’effet va ensuite monter progressivement, et l’impact complet sera réellement visible à partir de 2028.
Donc si on résume :
- Changement de réglementation publié il y a un an
- Applicable rétroactivement à des accidents survenus il y a un an et demi
- Avec un premier impact dans 6 mois
- Et un effet plein dans 3 ans
Autrement dit : si on ne commence pas à travailler le sujet dès maintenant, les entreprises risquent de subir l’augmentation de cotisation sans l’avoir anticipée — avec trois ans de retard.
FLORENCE BERNIER : Donc, si je comprends bien, les premières cotisations pleinement impactées par cette réforme ne seront payées qu’en 2030-2031, ce qui est vraiment trop éloigné pour réagir efficacement. C’est donc l’importance d’en parler dès maintenant.
Je comprends mieux pourquoi ce sujet mérite notre attention aujourd’hui : la rétroactivité commence début 2024.
En revanche, c’est peut-être aussi pour cette raison qu’on n’en entend pas encore beaucoup parler…
JÉRÔME LIEUTIER: Exactement. Ce sujet commence à susciter beaucoup d’intérêt, notamment dans les réseaux spécialisés, et nous en discutons régulièrement avec nos clients.
L’accidentologie liée au travail temporaire commence à apparaître dans les statistiques des entreprises utilisatrices, notamment via le fameux Compte Net Entreprise. Depuis quelques semaines, ces entreprises constatent l’impact des dépenses liées à l’intérim, désormais réparties selon le nouveau rapport 50/50.
Mais attention : ce 50/50 n’est pas exactement le même pour toutes les entreprises.
FLORENCE BERNIER : Ah.
JÉRÔME LIEUTIER: Ah désolé, Florence, on avait promis un sujet un peu technique et pas forcément très drôle !
En réalité, chaque entreprise a sa part de coût liée à ce qu’on appelle le CTN. Et ce coût varie selon le secteur d’activité, car tous les secteurs n’ont pas la même gravité ni le même poids en matière d’accidents.
Par exemple, un arrêt de travail de plus de 151 jours — ce que l’on appelle une unité 6, le maximum dans la classification des arrêts — représente, côté travail temporaire, un coût théorique d’environ 50 000 €.
FLORENCE BERNIER : Ok…
JÉRÔME LIEUTIER: Pour prendre un exemple concret, si l’on considère le secteur du transport, le coût théorique d’une unité 6 est d’environ 36 000 €, soit déjà 20 % de moins que dans d’autres secteurs. Dans la chimie ou le BTP, ce coût monte à 41 000 €.
Ainsi, même si l’on applique le principe du 50/50, l’équilibre n’est pas parfait : l’entreprise de travail temporaire paiera 50 % d’une base à 30 000 €, tandis que son client dans la chimie ou le BTP paiera 50 % d’une base à 41 000 €.
C’est pour cette raison qu’il est important que tout le monde comprenne bien cette logique : le 50/50 rééquilibre les droits et devoirs, mais le coût réel reste inégal, car la base théorique sur laquelle se calcule le partage varie selon le secteur d’activité.
FLORENCE BERNIER : Attends, je veux être sûre de bien comprendre : ce 50/50 ne correspond pas à 50 % du même coût pour l’entreprise utilisatrice et pour l’ETT ?
JÉRÔME LIEUTIER: Non, ce n’est pas exactement 50 % du même coût. En réalité, chaque partie paie 50 % de deux bases différentes, qui peuvent varier de 30 000 à 41 000 € pour un arrêt long. Et si l’on ajoute l’impact de la masse salariale, l’écart peut être encore plus important.
Prenons un exemple concret : une papeterie de 400 salariés, avec une masse salariale de 26 à 27 millions d’euros, où un salarié subit un accident entraînant une incapacité permanente de 20 %. Dans ce cas, l’entreprise utilisatrice devra supporter un surcoût de 33 000 €.
Pendant ce temps, une ETT avec une agence de 80 personnes et une masse salariale de 2 millions d’euros aura, pour sa part, un surcoût de cotisation de seulement 21 %.
Autrement dit, dans cet exemple, le 50/50 peut générer un écart de plus de 60 % entre l’entreprise utilisatrice et l’ETT.
C’est ce qu’on appelle parfois le principe du “pollueur-payeur” : le coût réel dépend de la masse salariale, de la sinistralité et du secteur d’activité. Mais la première inégalité est déjà dans le fait que le 50 % appliqué n’est pas identique pour chacun.
Objectif principal : renforcer la prévention des accidents du travail dans l’intérim
FLORENCE BERNIER : Tout à fait. Ça soulève plein de questions… Du coup, cette réforme de l’année dernière, quel est exactement son objectif ?
Je veux dire, j’imagine bien qu’elle n’a pas été faite juste pour faire payer plus les entreprises utilisatrices, alors que ça coûte moins cher aux ETT. Alors, quel était le but réel de cette réforme ?
JÉRÔME LIEUTIER: Le but premier c’est de réimpliquer pleinement l’entreprise utilisatrice dans la prévention.
Le but principal de cette réforme est de réimpliquer pleinement l’entreprise utilisatrice dans la prévention. Comme on le dit toujours : le meilleur accident est celui qui n’arrive pas. Il n’est pas logique de quitter le travail le soir dans une santé moins bonne que celle avec laquelle on est arrivé le matin.
Depuis des années, cette démarche est portée par le Prisme, le syndicat professionnel des entreprises de travail temporaire. L’idée est de ramener un équilibre, notamment sur la prévention et l’implication des entreprises utilisatrices.
Concrètement, si une EU doit désormais payer davantage, elle est incitée à agir en amont : préparer les postes de travail, protéger ses salariés, protéger ses intérimaires, et donc éviter que l’accident se produise.
En réalité, ce coût supplémentaire n’est pas un simple moyen de collecter plus d’argent. C’est exactement comme les radars sur les routes : ils existent pour nous inciter à ralentir et réduire les accidents, pas pour remplir les caisses.
C’est un peu le même principe de rééquilibrage.
Le seul bémol, c’est que, dans les détails, certains déséquilibres périphériques se sont créés… mais nous y reviendrons certainement dans quelques minutes.
FLORENCE BERNIER : Ah oui, sans aucun doute. Le fait que les coûts augmentent pour les EU, mais que le but soit de renforcer la prévention, je trouve ça vraiment positif.
Cela dit, je me pose la question suivante : si je dois m’impliquer davantage dans la prévention parce que ça me coûte plus cher, quelles sont exactement mes responsabilités ?
En tant qu’entreprise utilisatrice, je ne suis pas l’employeur direct du salarié temporaire. Mais je reste responsable de son travail au quotidien, c’est moi qui lui indique ce qu’il doit faire.
Donc, oui, cela va augmenter mes coûts et me donner davantage d’obligations en matière de prévention des risques professionnels.
Rôles et responsabilités face aux accidents du travail et l’intérim
FLORENCE BERNIER : Mais en tant qu’EU, je dispose aussi de droits, et sauf erreur de ma part… — et encore une fois, c’est un sujet très technique que je ne maîtrise pas complètement, surtout avec les ETT —, lorsqu’un travailleur temporaire me déclare un accident du travail, j’imagine que j’ai à peu près les mêmes droits qu’un employeur classique.
JÉRÔME LIEUTIER: C’est un peu plus complexe que de répondre simplement par “oui” ou “non”.
En réalité, l’entreprise de travail temporaire (ETT) est l’employeur officiel du salarié. Elle est donc la seule à avoir des droits et des devoirs liés à l’emploi.
L’entreprise utilisatrice (EU), elle, utilise la compétence d’un salarié mis à disposition par l’ETT. Son rôle n’est pas celui d’un employeur classique, mais elle a une responsabilité spécifique vis-à-vis du salarié pendant sa mission.
Concrètement :
- L’ETT : son rôle principal en matière de prévention est de s’assurer que le salarié a les qualifications nécessaires, qu’il est en bonne santé et qu’il est adapté au poste (compétences, sécurité, profil-poste).
- L’EU : elle est responsable du salarié pendant la durée de sa mission et sous son autorité. Sa mission première est de garantir la sécurité sur le poste de travail :
- fournir l’équipement de protection individuelle nécessaire,
- donner toutes les consignes et formations nécessaires,
- s’assurer que le salarié sait utiliser les machines et respecte les consignes de sécurité.
On voit donc qu’il y a une coresponsabilité, mais avec des droits et des devoirs différents entre ETT et EU.
Et puis ensuite… arrive la phase de l’accident, qui introduit d’autres questions.
FLORENCE BERNIER : Oui…
JÉRÔME LIEUTIER: Lorsqu’un accident survient, le premier acteur à intervenir est l’entreprise utilisatrice. C’est elle qui connaît le salarié, qui est présent sur ses locaux, qui a donné les consignes, et qui est témoin direct de l’accident.
La mission de l’EU consiste donc à rédiger une déclaration préalable qu’elle transmettra :
- dans les 24 heures à l’ETT,
- et à l’inspection du travail.
En pratique, c’est l’entreprise utilisatrice qui dispose des premiers éléments et qui est souvent la seule à les connaître sur place.
De son côté, l’entreprise de travail temporaire dispose de 48 heures pour effectuer la déclaration officielle d’accident du travail.
FLORENCE BERNIER : C’est donc la déclaration de l’employeur.
JÉRÔME LIEUTIER : Oui, exactement, celle de l’employeur que l’on connaît tous. L’ETT se base sur les informations fournies par l’entreprise utilisatrice via la déclaration préalable, ainsi que sur le récit du salarié concernant les circonstances de l’accident.
En pratique, l’entreprise utilisatrice rédige seulement une déclaration préalable. C’est ensuite l’entreprise de travail temporaire qui va adapter ces informations et rédiger la déclaration officielle d’accident du travail. L’EU ne fait donc pas la déclaration officielle elle-même.
FLORENCE BERNIER : L’entreprise utilisatrice n’a donc pas de droit de regard sur ce que fait l’ETT ?
JÉRÔME LIEUTIER: Pas vraiment. L’EU n’est pas l’employeur, elle n’est donc pas partie prenante de la procédure officielle.
Cela dit, certaines ETT acceptent de joindre à leur déclaration d’accident du travail un courrier de l’entreprise utilisatrice, afin de lui donner la possibilité de faire part de son point de vue. Mais ce n’est pas un droit légal. Et d’ailleurs, la CPAM n’est pas obligée de prendre ce document en compte : il est simplement joint au dossier.
FLORENCE BERNIER : Attends, il y a quelque chose qui me gêne un peu. On vient de dire que les coûts liés aux accidents augmentent pour les entreprises utilisatrices, mais si je comprends bien, elles ne font pas elles-mêmes la déclaration officielle.
Donc, même si les relations contractuelles se font en bonne foi — et je n’en doute pas —, l’ETT peut rédiger la déclaration comme elle l’entend, et l’entreprise utilisatrice peut seulement émettre des réserves.
JÉRÔME LIEUTIER: Non, l’entreprise utilisatrice ne peut pas émettre de réserves officielles. Seule l’entreprise de travail temporaire peut le faire, car c’est elle l’employeur.
De la même manière, lorsque la CPAM prend une décision — qu’elle prenne en charge ou non l’accident — seule l’ETT peut la contester officiellement. L’entreprise utilisatrice, même si elle paie 50 % de la dépense, n’a pas ce droit, car elle n’est pas l’employeur.
Un arrêt de la Cour de cassation de 2018 a confirmé que l’entreprise utilisatrice n’a pas la “qualité à agir”, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas contester une décision liée à l’accident.
C’est là que se situe le principal déséquilibre :
- L’entreprise utilisatrice est coresponsable de la sécurité, ce qui est logique.
- Elle est également coresponsable du financement, ce qui est normal.
- Mais elle ne peut ni s’exprimer officiellement ni contester une décision qui lui est partiellement imputable.
Pour moi, ce manque de droit de contestation, combiné à l’absence de participation à la procédure déclarative, est préjudiciable, car il limite l’action d’un acteur clé de la prévention.
Chiffres clés sur les accidents du travail et l’intérim
FLORENCE BERNIER : Oui, surtout, Jérôme, peux‑tu me dire combien il y a d’intérimaires en France ?
JÉRÔME LIEUTIER: L’activité intérimaire fluctue selon les périodes, avec des phases de hausse et de baisse. Mais en moyenne, on compte environ 650 000 intérimaires par an.
FLORENCE BERNIER : ok.
JÉRÔME LIEUTIER: Pour mettre les choses en perspective : avec environ 650 000 intérimaires par an, on observe chaque année plusieurs dizaines de milliers d’accidents du travail. Par exemple :
- en 2021, il y a eu 50 000 accidents,
- en 2022, un peu moins, soit 45 000 accidents.
Donc, même si le nombre d’intérimaires fluctue, beaucoup de personnes sont concernées par ces accidents.
FLORENCE BERNIER : Exactement. Donc ce n’est vraiment pas anecdotique.
JÉRÔME LIEUTIER: Non, ce n’est vraiment pas anecdotique. L’intérim représente une part importante de l’emploi en France, souvent sur des postes moins qualifiés et par nature temporaires, même si certains contrats peuvent être en CDI.
Ces emplois temporaires servent souvent de renfort, mais ils sont plus exposés aux accidents. Avec 45 000 à 50 000 accidents du travail par an, le risque pour un intérimaire est deux fois plus élevé que pour un salarié permanent à population égale.
Ceci s’explique par le fait qu’un intérimaire arrive sur un poste de renfort, parfois le matin même, sans connaître parfaitement l’entreprise utilisatrice ni les procédures. Par exemple, il n’est pas toujours possible de faire un brief complet à 6h du matin sur une plateforme logistique.
C’est pour cette raison que le rééquilibrage financier a été mis en place : il vise à inciter les entreprises à mieux prévenir les accidents, plutôt que de simplement supporter les coûts après coup.
En résumé, le risque est aujourd’hui deux fois plus élevé pour un intérimaire que pour un salarié permanent.
Leviers RH pour réduire le risque AT dans l’intérim
FLORENCE BERNIER : Je comprends beaucoup mieux. Quand tu parlais de rééquilibrage — même si nous reviendrons sur l’arrêt de la Cour de cassation de 2018, car en tant que juriste, il est important pour moi de soulever ces subtilités — la première chose, c’est ce que tu viens de dire : les intérimaires sont deux fois plus exposés aux accidents du travail que les salariés permanents.
Donc, quelque part, je comprends maintenant pourquoi rééquilibrer les coûts a du sens. Cela incite les entreprises utilisatrices à limiter les accidents et à mettre en place un maximum de prévention.
C’est crucial, car comme tu le soulignes, ces intérimaires arrivent souvent parce qu’on a besoin d’eux immédiatement, et il n’est pas toujours possible de les former ou de les encadrer autant qu’un salarié permanent.
JÉRÔME LIEUTIER : Sur des missions d’urgence, on dispose moins de temps pour la prévention.
FLORENCE BERNIER : Bien sûr, le temps manque.
Ça m’amène à revenir sur cette décision de la Cour de cassation de 2018. Tu me dis qu’on a retiré aux entreprises utilisatrices leur qualité à agir, mais qu’est-ce que cela signifie exactement ?
Est-ce une carence, un problème législatif, ou une volonté délibérée du législateur de leur retirer ce droit ?
JÉRÔME LIEUTIER: Je ne sais pas si c’était volontaire, mais en 2018, la Cour de cassation a statué sur ce point. À l’époque, j’étais davantage côté des entreprises de travail temporaire, donc je n’ai pas tous les détails, mais l’arrêt a clairement dit :
« L’entreprise utilisatrice n’est pas l’employeur, elle n’a pas le droit de contester un accident d’un salarié qui n’est pas le sien. »
Cette décision concerne principalement le travail temporaire, mais elle peut avoir d’autres impacts. Par exemple, si un salarié d’une entreprise précédente a eu un accident, l’entreprise actuelle ne peut pas contester non plus, car ce salarié n’est pas le sien.
La particularité légale, c’est que la Cour de cassation a retiré une qualité à agir, alors qu’en réalité elle n’avait pas la capacité de le faire. Aujourd’hui, cette décision est jurisprudence, suivie par les tribunaux et les cours d’appel. Le seul moyen de corriger cette situation serait l’intervention du législateur.
Ce sujet me tient particulièrement à cœur. Le monde du travail temporaire considère que cette absence de droit fait peser sur l’ETT toute la pression que devrait assumer l’entreprise utilisatrice. De l’autre côté, les entreprises utilisatrices souhaiteraient simplement pouvoir exprimer leur point de vue, sans contester officiellement, tout en acceptant de payer leurs 50 %.
FLORENCE BERNIER : C’est ça.
JÉRÔME LIEUTIER : Même le monde politique en parle. Aujourd’hui, nous avons la chance d’échanger avec des présidents de commission, des députés et des économistes, qui reconnaissent que ce point a visiblement été oublié lors de la réforme de juillet 2024.
Mais il ne faut pas oublier le contexte : changement de gouvernement, contraintes budgétaires… Tout cela a eu un impact sur le risque AT/MP, et le taux 2025 n’a été publié qu’en mai. Le législateur nous a donc indiqué que ce n’était pas le bon moment pour intervenir, et qu’il fallait attendre une période de stabilité.
Pour nous, ce sujet reste très actif. Il ne s’agit pas d’argent, mais de droit à la parole : permettre à chaque acteur de remplir pleinement son rôle, que ce soit en prévention ou en contestation lorsqu’on n’est pas d’accord avec une décision de la CPAM.
FLORENCE BERNIER : Exactement. J’ose espérer que c’est un oubli législatif, parce que je comprends aussi le point de vue de l’ETT : c’est leur salarié.
Mais pour l’entreprise utilisatrice, qui assiste ou constate l’accident, c’est vraiment frustrant de ne pas avoir la main.
Dans l’attente d’une intervention du législateur, quels leviers pourraient avoir ces entreprises utilisatrices pour ne pas se contenter de subir la situation ?
JÉRÔME LIEUTIER: Le premier levier, c’est évidemment la prévention : tout le monde veut éviter l’accident.
Une fois l’accident survenu, le plus important est de maintenir un lien de proximité avec l’entreprise de travail temporaire. Ce n’est pas un opposant, ni un centre de coût, ni une tierce personne : c’est un partenaire du salarié, puisque le salarié est partagé entre les deux structures.
Le premier moyen concret est donc de discuter avec l’ETT et, par exemple, de proposer qu’un courrier de l’entreprise utilisatrice soit joint à la déclaration d’accident du travail. Cela permet de participer et de donner sa voix au chapitre.
Deuxième levier : travailler le risque AT/MP lié à l’intérim avec l’ETT. Cela peut inclure :
- demander des analyses et des chiffres,
- accompagner certains cas spécifiques, notamment en cas de désaccord sur la prise en charge,
- utiliser les services d’experts ou d’avocats tiers pour rédiger des réserves ou courriers officiels à l’administration.
Si la réserve initiale ne suffit pas et que l’accident est pris en charge, il est également possible d’intervenir conjointement dans un contentieux.
Je m’explique…
FLORENCE BERNIER : Ouais.
JÉRÔME LIEUTIER : L’entreprise utilisatrice n’a toujours pas la qualité à agir, elle ne peut pas aller en justice pour le moment.
Donc, quand une contestation doit être lancée, c’est forcément l’entreprise de travail temporaire qui le fait. Or, économiquement, elle n’a pas toujours intérêt à contester.
En revanche, elle a tout intérêt à représenter l’intérêt commercial de son client, l’entreprise utilisatrice, dans une contestation commune.
Ce que nous faisons de plus en plus aujourd’hui, c’est de mettre en place une co‑contestation : à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire, l’entreprise utilisatrice est appelée à participer à la procédure. Rien n’empêche ensuite les deux parties de travailler ensemble pour répartir équitablement les coûts de la procédure.
FLORENCE BERNIER : Oui. Et l’entreprise de travail temporaire a effectivement un intérêt économique et commercial, comme tu le soulignes.
Parce que si je me retrouve face à une ETT qui ne tient pas compte de mes remarques et ne m’accompagne pas, alors que je n’ai pas le droit d’agir moi-même, je pense que je changerais de prestataire.
JÉRÔME LIEUTIER: Oui, effectivement. Aujourd’hui, on se rend compte que les 6 premiers mois de la réforme ont été assez calmes.
Cependant, certaines entreprises utilisatrices réalisent que l’ETT — qu’il s’agisse d’une petite agence indépendante ou d’une structure de taille réduite — n’a pas toujours d’intérêt économique à agir. Cela peut créer un rapport de force et pousser l’entreprise utilisatrice à vouloir tout savoir de la situation.
Dans des cas très marginaux, cela peut même amener certaines EU à demander à l’ETT de ne pas tout déclarer, ce qui reste rare mais doit être surveillé.
FLORENCE BERNIER : Ah ! Ou d’accord
JÉRÔME LIEUTIER: Ce serait une mauvaise interprétation de cette idée. Il est essentiel que tous les acteurs puissent s’exprimer pour rééquilibrer la connaissance et la transparence.
Je reste convaincu que si l’entreprise utilisatrice pouvait émettre des réserves et consulter directement le dossier auprès de la CPAM, sans passer par l’intermédiaire de l’ETT, elle gagnerait du temps, et la procédure pourrait se faire en coréalisation, tout en évitant le rapport de force du type « fais ceci sinon je change d’agence ».
Il ne faut pas oublier que le coût du travail temporaire est calculé en pourcentage du salaire, et que le premier regard de l’entreprise utilisatrice est souvent : « soit mon accidentologie reste maîtrisée, soit demain on réajuste les prix ». Cette pression commerciale est donc réelle.
Aujourd’hui, sur les cotisations liées aux accidents du travail pour les entreprises utilisatrices, on parle d’une enveloppe d’environ 160 millions d’euros par an.
FLORENCE BERNIER : Donc ce n’est vraiment pas neutre.
JÉRÔME LIEUTIER: Exactement. Quand un rééquilibrage entraîne une hausse de 20 à 30 %, cela représente une charge réelle pour l’entreprise.
Cette charge devrait ensuite se transformer en actions de prévention pour limiter les accidents, ce qui est vraiment le but.
Mais à court terme, tant que l’entreprise utilisatrice n’a pas la parole, ces tensions peuvent être contre-productives pour les deux parties.
FLORENCE BERNIER : Donc on comprend bien que tout cela est contre-productif, autant pour la prévention que pour l’accompagnement du salarié.
FLORENCE BERNIER : OK. Alors, il y a un dernier point que j’aimerais revoir avec toi dans cet épisode.
J’ai bien compris tous les éléments : les impacts financiers pour l’entreprise utilisatrice, son absence de droit d’agir actuellement…
Mais ce qui m’a particulièrement marqué, c’est quand tu disais que cette réforme vise surtout à renforcer la prévention et l’implication de l’EU, et que les intérimaires sont deux fois plus exposés aux accidents du travail.
Je crois que ce n’est pas ma spécialité, mais tu évoquais le taux de fréquence.
Si tu es d’accord, pourrais‑tu nous rappeler la définition du taux de fréquence et le constat que tu en as fait concernant les intérimaires ?
JÉRÔME LIEUTIER: En fait, le taux de fréquence correspond au nombre d’accidents du travail survenus pour 100 salariés sur une année. Par exemple, si sur 100 salariés, il y a deux accidents, le taux de fréquence est de deux.
Pour les travailleurs temporaires, on observe deux fois plus d’accidents graves que pour les salariés permanents. Ce n’est donc pas le taux de fréquence global qui double, mais celui des accidents graves. Les accidents bénins restent nombreux et doivent être déclarés, mais ce sont les accidents graves qui exposent davantage le salariat temporaire.
Cet indicateur est crucial à connaître, que l’on soit du côté des salariés permanents ou intérimaires. Je discutais récemment avec un client dans le secteur du transport, qui m’a expliqué : « Je suis assez fier d’avoir le même taux de fréquence pour mes permanents et mes intérimaires. »
Cela signifie qu’il protège ses salariés de manière équitable : les moins expérimentés sont affectés à des postes moins risqués, et les plus expérimentés aux postes plus techniques ou plus exposés. Par exemple, un intérimaire qui arrive dans une zone logistique qu’il ne connaît pas ne commencera pas immédiatement par un poste dangereux comme le transpalette pour la préparation de palettes en hauteur sur des commandes urgentes.
FLORENCE BERNIER : En tout cas, je ne devrais pas, c’est évident.
JÉRÔME LIEUTIER: Oui, dans leur approche, ils pilotent vraiment ces indicateurs. Le fait de maintenir une équivalence du taux de fréquence entre intérimaires et salariés permanents montre qu’on gère correctement l’expérience du salarié, sa connaissance du poste et les risques associés.
À l’inverse, si le taux de fréquence ou le taux de gravité est plus élevé pour les intérimaires, cela indique peut-être une lecture différente de l’employabilité et de la gestion des remplacements. Dans ce cas, il peut être nécessaire d’ajuster les affectations pour lisser les risques et éviter les accidents.
En résumé, il s’agit de prévenir, adapter chaque salarié à son poste et surveiller sa manière de travailler, afin qu’il reparte en aussi bonne santé le soir qu’à son arrivée le matin.
JÉRÔME LIEUTIER: Dans leur approche, les entreprises pilotent ces indicateurs. Maintenir l’équivalence du taux de fréquence montre qu’on gère correctement le rapport entre l’expérience du salarié, sa connaissance du poste et les risques associés.
À l’inverse, si le taux de fréquence ou le taux de gravité est nettement plus élevé pour les intérimaires, cela peut révéler une différence dans la gestion des remplacements ou l’employabilité. Il faut alors ajuster les affectations pour réduire les risques et prévenir les accidents.
En pratique, cela signifie : prévenir les risques, adapter chaque salarié à son poste, et surveiller sa manière de travailler, pour qu’il reparte en aussi bonne santé le soir qu’à son arrivée le matin.
FLORENCE BERNIER : Ce que tu dis sur les remplacements m’interpelle, car je n’y avais pas pensé. En fait, tu veux dire que recourir à un intérimaire ne se résume pas forcément à remplacer un salarié absent. Il s’agit aussi de réfléchir différemment à l’affectation des équipes : placer un salarié permanent plus expérimenté sur les postes à risque, et utiliser l’intérimaire sur des missions moins sensibles.
C’est pour toi le vrai levier RH dans ce contexte ?
JÉRÔME LIEUTIER: Oui, c’est un vrai levier. On parle de remplacement par glissement de poste : un salarié prend le poste de Paul, Paul prend celui de Marc, et ainsi de suite. Cela permet de remplacer indirectement un salarié tout en restant conforme au droit du travail, c’est-à-dire en respectant la durée, la rémunération et l’organisation prévues.
FLORENCE BERNIER : Il faut bien que le salarié remplacé soit mentionné dans le contrat de travail pour que ce soit clair.
JÉRÔME LIEUTIER: Exactement. Dans ce cas, le glissement de poste permet non seulement de gérer le remplacement, mais aussi de rééquilibrer les risques liés aux missions. C’est donc aussi une bonne pratique de gestion des ressources, particulièrement dans le contexte du travail temporaire et de l’accidentologie.
FLORENCE BERNIER : Ah oui, je comprends mieux maintenant. Avant, j’appelais ça le remplacement en cascade : une personne qui remplace une autre, qui elle-même remplace quelqu’un d’autre. Avec le terme glissement de poste, on comprend aussi que le remplacement peut s’organiser différemment : l’intérimaire n’est pas forcément mis sur le poste exact de la personne absente, surtout si ce poste présente des risques.
Je trouve cette idée vraiment intéressante et utile : placer les intérimaires les moins expérimentés sur les postes les moins dangereux. C’est clairement une piste d’amélioration que je retiens.
JÉRÔME LIEUTIER: Exactement. Pour protéger tout le monde, il faut placer les salariés les mieux formés sur les postes les plus à risque, et les moins expérimentés sur les postes les moins dangereux. Cela permet de sécuriser l’ensemble des collaborateurs, intérimaires ou permanents.
FLORENCE BERNIER : Je crois que ce sera un mot de prévention pour conclure. L’accident du travail, c’est un événement qui survient alors que le salarié est au service de son employeur, et il peut être grave, voire mortel. Il est donc essentiel que l’entreprise mette tout en œuvre pour les éviter et développe sa politique de prévention. Mais il est tout aussi important de rappeler qu’il faut un peu de justice : l’entreprise utilisatrice ne doit pas tout subir seule. Lorsqu’elle agit correctement, elle doit pouvoir avoir son mot à dire, comme tu l’as souligné plusieurs fois. Je note qu’il y a des évolutions législatives à venir, que je suivrai de près. Merci beaucoup pour tous ces apports, c’était vraiment passionnant. Rendez-vous pour un prochain épisode !
JÉRÔME LIEUTIER: Merci Florence, à bientôt.
Vous souhaitez aller plus loin et approfondir votre expertise RH ?
Abonnez-vous à notre newsletter et recevez chaque mois : nos avis d’experts Ayming, actualités du secteur, événements, témoignages, et bien plus encore…

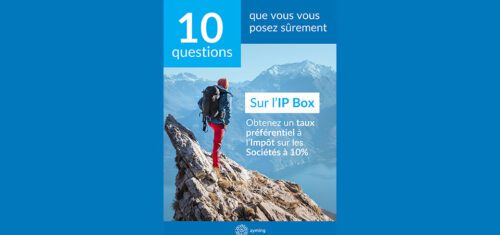











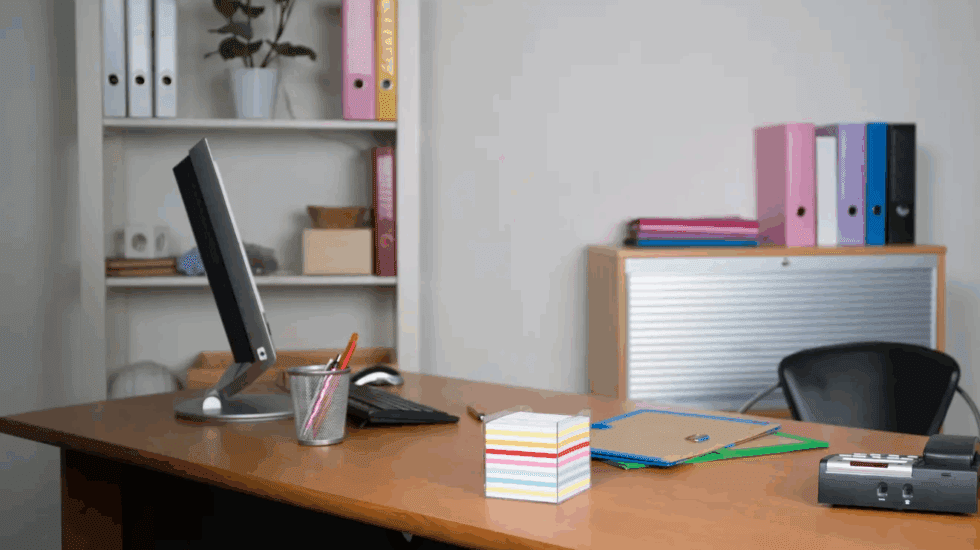



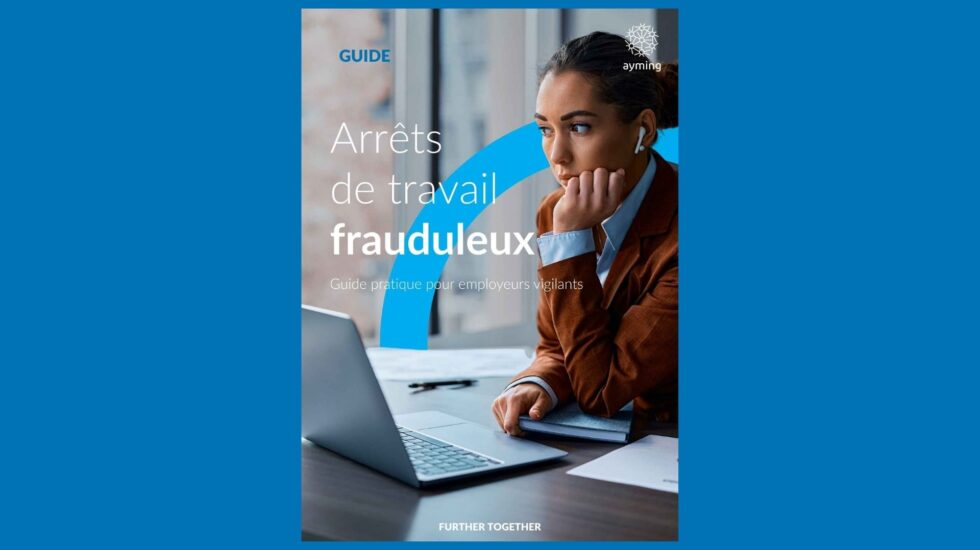
Aucun commentaire